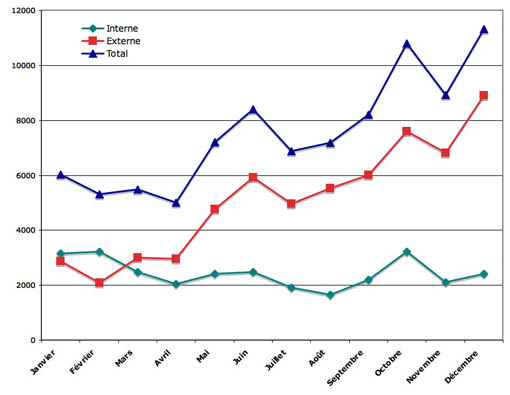L’heure des choix arrive.
Bien sûr, l’heure sera longue, une université ne fait pas ses choix en un instant, ni dans la précipitation, mais l’annonce faite lors de ma deuxième rentrée académique : « se définir » doit s’accomplir durant cette année, partout où nous pouvons le faire.
Durant l’année académique 2005-2006, certaines options avaient été prises d’emblée, certains principes avaient été acquis, tels que celui de rendre à l’ULg son rôle moteur dans le domaine culturel, celui de prendre des mesures significatives au plan social, de renforcer les structures de recherche et d’aide à la recherche, de mieux doter les supports pédagogiques et de simplifier les mesures administratives.
On pouvait, en effet, prendre de telles mesures d’emblée, sans recourir à une vaste consultation ni à une évaluation, interne ou externe.
J’ai eu l’occasion, dans mon discours de rentrée, de faire le point sur tous les accomplissements déjà réalisés ou en cours de réalisation (http://recteur.blogs.ulg.ac.be/?page_id=82).
Aujourd’hui, nous devons nous définir et annoncer clairement qui nous voulons être, quelle sorte d’université, avec quels atouts, quels points forts. Je résumerai en une question : qu’est-ce qui, à l’ULg, est spécifique et original, au plan international ou au plan de la Communauté française de Belgique ?
Je sais que je devance, en prenant cette position, les conclusions à tirer des différentes phases du regard porté par l’Institution sur elle-même (autoévaluation, évaluation, tables rondes, enquête) mais, pour ce que nous en savons déjà, il n’y aura pas de surprise à cet égard.
Quels peuvent être les éléments qui confèrent à une université sa réputation et son attractivité, tant pour les étudiants que pour les chercheurs et les enseignants ?
- sa structuration : la localisation géographique; l’organisation du ou des campus; la mobilité et les transports entre les sites et entre l’université et la ville; la beauté et le confort du ou des sites; l’accessibilité des bâtiments; la disponibilité des locaux, des auditoriums, de salles d’étude pour étudiants; la convivialité des lieux de détente; l’accès à des magasins, des lieux de spectacle, des restaurants bon marché de qualité, des cafétarias, etc.; les possibilités de logement, même temporaire.
- sa recherche : une qualité de niveau international reconnue dans des domaines pointus, une originalité qui fait que l’on associe cette recherche à l’Institution, des capacités d’accueil de chercheurs internationaux dans des structures dotées de moyens significatifs et compétitifs compte tenu du domaine de recherche considéré, une dynamique et une masse critique de chercheurs qui identifient l’université comme un centre de compétence dans le domaine, de dimension suffisante pour pouvoir établir des relations efficaces avec le monde extérieur, le monde industriel, le monde des entreprises en général, qu’elles soient privées ou publiques, permettant ainsi un apport financier significatif aux recherches fondamentales sans déteriorer ou étouffer celles-ci.
- son enseignement : une qualité réputée, mesurée par des indicateurs structurés et modernes (sans tomber dans le travers du remplacement systématique des méthodes d’enseignement par des nouveautés à la mode), mesurée par une évaluation complète ne se limitant pas à l’avis des étudiants mais tenant compte, parmi d’autres éléments, de celui-ci; un éventail large de techniques pédagogiques venant en aide aux étudiants et chaque fois idéalement adaptées aux circonstances et aux objectifs; un lien direct avec la recherche, par conséquent un choix des orientations spécialisées basé sur l’excellence en recherche, ce qui implique une sélection des domaines enseignés basée sur les spécificités locales.
On le voit, se définir, c’est aussi décider ce que l’on garde et ce que l’on sacrifie.
D’aucuns me disent que mon affirmation : « on ne peut faire tout partout » est abusive et que, dans notre grand jardin, il faut savoir tout cultiver.
Ma réponse serait oui, si nous disposions de suffisamment de jardiniers. Mais hélas, ce n’est pas le cas et il faut se rendre à l’évidence, comme on aurait déjà dû le faire depuis longtemps (réalisme ne veut pas dire défaitisme), nous n’avons pas les moyens de tout enseigner dans notre université. Nous n’avons en tout cas pas les moyens de le faire bien, c’est-à-dire en faisant reposer notre enseignement sur une véritable expérience dans les domaines enseignés. Notre universalisme, valeur que je salue et que j’aimerais pouvoir entretenir, repose souvent pour partie sur des connaissances livresques ou de seconde main. Quoi de plus stupide que de maintenir une recherche de faible qualité pour assurer l’enseignement dans un domaine particulier, pour lequel les capacités, l’expérience, la compétence, l’excellence sont ailleurs ? Quoi de plus absurde que de vouloir maintenir des cursus d’études (je parle des seconds ou troisièmes cycles) dont la majorité des cours sont donnés par des enseignants qui n’y sont pas dans leur spécialité ?
Nous devons soutenir activement, chaque fois que nous en avons la possibilité, les domaines de recherche où nous excellons, où nous tenons notre rang au niveau international si nous n’en avons pas la stricte originalité, et ceci au détriment des recherches où nous tenons un rang moyen ou inférieur et pour lesquelles la justification de continuer ne tient que par le désir de laisser tout pousser, même ce qui est banal.
Nous devons soutenir activement les domaines de recherche où nous sommes les premiers, voire les seuls à détenir les compétences ainsi que le savoir-faire, et promouvoir ces domaines de toutes nos forces.
Nous devons proposer des filières d’enseignement, orientations, options, portant prioritairement sur ces domaines, afin d’en assurer la continuité et la primauté dans l’avenir.
Je sais que cette attitude fait bondir. Elle fait bondir ceux qui répugnent — et on les comprend — à admettre eux-mêmes que leur domaine de recherche est secondaire, voire de qualité moyenne. Aucun universitaire n’est spontanément prêt à admettre cet état de fait. Toute sa vie, il (ou elle) a été confronté(e) à des processus sévères qui ont sélectionné son tempérament de battant(e) et il (elle) n’est pas prêt(e) à reconnaître ce qu’il (elle) considérerait comme un échec. Et pourtant, c’est la réalité et il faut, dans l’intérêt collectif pour une fois, savoir l’admettre. Je suis de ceux qui admirent la conviction avec laquelle chaque universitaire défend son domaine individuel, son pré carré, mais j’ai clairement la vision que cet individualisme nous conduira à notre perte.
Plus difficile encore : certains parmi nous sont au sommet de leur carrière de recherche et apparaissent nettement comme des spécialistes internationaux de premier plan dans le domaine qu’ils ont développé. Nulle médiocrité chez eux, nulle banalité. Les spécialistes du monde entier les considèrent comme des maîtres. Mais ils n’ont pas développé ou pu développer, pour quelque raison que ce soit, une équipe forte, avec des successeurs du même acabit qu’eux-mêmes, susceptible de prendre la relève et d’assurer la pérennité du champ de recherche qu’ils ont développé. Là également, il faut savoir regarder les choses en face et s’interroger lucidement sur les chances de voir ce domaine continuer à fleurir richement ou sur le risque qu’il court de se flétrir au fil des ans après le départ du pilote.
Il est bien évident que toutes ces circonstances, pour tristes qu’elles soient, doivent nous inciter à mettre au point des procédures d’estimation et d’évaluation neutres et impartiales.
En aucun cas, les choix ne doivent émaner du recteur lui-même. Sa mission est de sauver le navire, de le faire croître et embellir et de lui amplifier son éclat et sa renommée. Le rôle du capitaine est d’encourager l’équipage à faire ses choix, en fonction de ses compétences, et souvent même d’exiger de l’équipage qu’il fasse ces choix, précisément.
Mais les choix eux-mêmes doivent émaner de la base, de là où le jugement peut le mieux être porté, pour autant que les inévitables querelles de voisinage ou d’influence soient neutralisées par l’intérêt général. Et la meilleure base aujourd’hui, c’est le département.
La décision d’entreprendre des choix peut s’orienter « top-down » mais le choix lui-même doit se faire « bottom-up ».
Au moment de l’élaboration du budget 2007, mais aussi au moment où le virage important que nous avons pris depuis un an se termine, il est essentiel d’entamer aujourd’hui ce processus de sélection, de choix des options qui se présentent à nous. C’est dans l’imagination et la créativité que nous devons faire ces choix. Nous devons comprendre que, pour créer des filières à la fois utiles et attractives, nous devons revoir le bien fondé des cursus désormais classiques, nous devons tout remettre en question. Cela ne nous empêchera pas de décider qu’éventuellement on conserve des filières inchangées, voire même une majorité de filières inchangées, mais alors nous le ferons en connaissance de cause. Il ne faut rien maintenir « parce qu’on a toujours fait comme cela », mais parce qu’il existe d’excellentes raisons de continuer à le faire.
Pour moi, sacrifier certains axes ne se justifie que dans le but d’en renforcer ou d’en créer d’autres. Aucun sacrifice ne doit être consenti s’il ne permet d’apporter assurément un renfort aux axes où nous excellons et où la relève et la pérennité sont assurées, ou aux axes nouveaux qu’il est temps de mettre en place. C’est là que le jugement des départements est en première ligne face à la responsabilité de la décision.
Toute décision d’abandonner des orientations devra faire l’objet d’une évaluation sérieuse et s’accompagner du renforcement de l’existant ou de la création de nouveautés justifiées. En outre, tout abandon de filière devra faire l’objet d’une vérification de l’existence de cette filière ailleurs ou être examiné à la lumière des possibilité d’organiser les enseignements en inter-universitaire, au mieux des compétences respectives.
C’est ainsi que notre université pourra au mieux se définir par rapport à l’extérieur et tout particulièrement vis-à-vis des étudiants. Plus il existera de filières spécifiques à propos desquelles le futur étudiant se dira « pour faire cela, c’est à Liège qu’il faut aller » et plus cet étudiant viendra de loin, mieux l’université se sera définie et aura atteint ses objectifs de notoriété et d’attractivité.