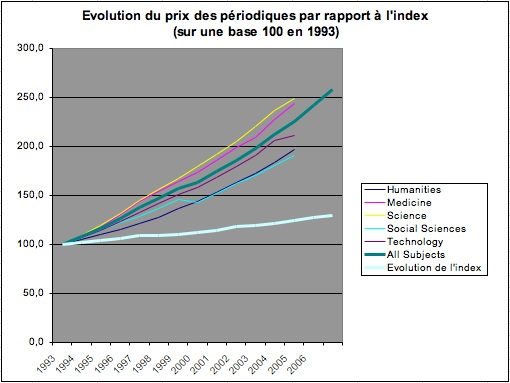Reçu le 19 janvier par courriel d’une lectrice qui a souhaité garder l’anonymat lorsque je lui ai demandé son accord pour afficher son message sur le blog.
En principe, je ne publie pas de message anonyme, mais je pense que celui-ci vaut la peine d’être lu car il révèle bien les incompréhensions que risque toujours de provoquer une information transmise par la radio et les inexactitudes qui, à travers les media, prennent auprès du public une totale crédibilité.
Monsieur le Recteur,
Etant moi-même germaniste de l’Université de Liège, j’ai été très surprise en entendant votre intervention hier matin à la radio Bel RTL. La tempête d’hier ayant tout à fait éclipsé ce sujet dans les journaux télévisés du soir, j’ai fait une recherche sur Internet ce matin, et l’information que vous avez donnée hier matin semble être tout à fait passée inaperçue et n’a pas été relayée par les médias que j’ai consultés sur le Net ce matin.
Je souhaiterais donc vous poser quelques questions.
- Ces 300h de langues seront-elles bien dans les programmes de cours des différentes facultés (et dans toutes les universités francophones) dès l’année prochaine, comme vous l’avez annoncé ?
- Comment et avec quel argent allez-vous organiser ces cours et où trouverez-vous les professeurs de langues capables de les assurer puisqu’en ce qui concerne les langues germaniques, l’offre de professeurs disponibles sur le marché de l’emploi n’est certainement pas pléthorique ?
- Vous ne l’avez pas mentionné explicitement, mais je suppose que ces heures de cours ne couvriront l’apprentissage que d’une seule langue puisque votre objectif est que les étudiants universitaires soient tous bilingues à la fin de leurs études.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me répondre car suite à vos propos, j’ai abordé ce sujet avec mes élèves de 5ème et 6ème et je pense qu’ils sont en droit de savoir à quoi s’attendre lors de la prochaine rentrée académique.
Je tiens également à vous donner mon avis de germaniste dans l’enseignement depuis 20 ans. Je pense que 6h de langues par semaine dans des filières scientifiques, c’est beaucoup trop. De plus, ces heures de langues ne permettront jamais à quiconque de devenir parfait bilingue* car je suppose que les cours ne seront pas donnés à de petits groupes d’étudiants. Le véritable problème, en ce qui concerne l’apprentissage des langues étrangères et qui explique le niveau très bas de certains élèves à la fin du secondaire, est le peu d’importance accordée à la langue « pure », à savoir la grammaire (surtout) et le vocabulaire. En effet, certains élèves sortant de rhétorique sont incapables d’écrire une phrase correcte en anglais parce qu’ils sont bons en compréhension à l’audition et à la lecture et ont donc toujours « réussi !!! » avec environ 50% des points dans les langues germaniques.
De plus, les élèves « réussissent » leur année scolaire même quand ils ratent un ou deux examens. Les élèves bénéficient trop souvent de faveurs lorsqu’ils n’ont qu’un ou deux échec(s). (NB : dans les textes, le redoublement d’une année dans le secondaire doit rester exceptionnel s’il n’y a qu’un échec et beaucoup d’élèves traînent de grosses lacunes dans une branche pendant toute leur scolarité).
Tant que nos inspecteurs et notre ministre ne comprendront pas cela, le niveau de certains élèves sortant du secondaire restera ce qu’il est. Un autre exemple représentatif est la médiocrité de l’orthographe de la plupart des élèves en français… et pourtant les collègues romanistes sont ceux qui mettent le moins d’échecs aux élèves.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Recteur, à mon profond respect.
Un Professeur d’anglais
* : Seuls les non-linguistes galvaudent toujours ce terme de parfait bilinguisme, qui n’est à ma connaissance accessible que dans deux cas :
- enfant élevé dès son plus jeune âge par des parents dans deux langues différentes
- séjour de LONGUE durée (au moins 4 ou 5 ans) à l’âge adulte qui permet d’acquérir la langue comme un « native speaker ».
Heureusement, le parfait bilinguisme n’est pas nécessaire pour s’exprimer aisément. Une bonne connaissance de la langue est tout à fait suffisante.
J’étais une étudiante brillante, j’ai toujours aimé les langues. J’adore l’anglais et je le pratique maintenant depuis 30 ans. Je considère que j’ai une excellente connaissance de l’anglais mais en aucun cas, je ne me considère comme « parfaite bilingue » !
**********
Chère Madame,
Merci pour votre courriel d’hier.
Je tiens à rectifier ou à préciser quelques points.
Je commencerai par dire que je n’ai pas entendu ma propre intervention sur Bel RTL et que, par conséquent, je ne puis être certain de tous les termes que j’ai pu employer. Il s’agissait malheureusement, comme c’est hélas souvent le cas, d’une interview faite au pas de course, par gsm, sans préparation et dans l’urgence journalistique qu’on connaît.
Tout d’abord, je n’ai jamais parlé (là, j’en suis sûr !) de 300 heures de cours de langues.
D’abord parce qu’il ne s’agit pas nécessairement de cours mais de formations. La nuance est importante, elle laisse toute liberté aux formateurs quant à la méthode à utiliser.
Ensuite parce que j’ai annoncé 5 crédits ECTS par an, soit un douzième du volume des enseignements d’une année de cours (60 crédits ECTS). C’est donc de l’ordre de 40 à 50 heures maximum par an, ce qui est très différent !
Comment et avec quel argent je vais réaliser cet objectif, c’est évidemment mon problème et cela ne regarde que moi ! Néanmoins, je vous remercie de votre sollicitude. Soyez rassurée, je gère sagement mon institution !
De même, pour ce qui est de la disponibilité d’encadrants, j’ai mes assurances. On m’a rapporté que la journaliste avait parlé d’engagement de professeurs, c’est inexact. Mon intention est de recruter des encadrants compétents, pas des professeurs, bien évidemment.
Je dois préciser que nous avons déjà à ce jour 191 formations en langues qui sont intégrées dans nos cursus d’études (années-filières), ce qui démontre la faisabilité du projet que je lance, puisqu’il est déjà largement en place. Je ne m’aventure donc pas dans des propositions inconsidérées.
Il s’agira en effet d’une seule langue, laissée au choix de l’étudiant et sur recommandation du conseil des études de la filière concernée. On peut en outre penser qu’un étudiant qui, au sortir du secondaire, connaîtrait bien une langue (parcours en immersion par exemple) puisse souhaiter en acquérir une autre, et ce serait fort bien. Les moins ambitieux profiteront peut-être de leur avance en langue pour choisir celle qu’il ont déjà apprise et consacrer plus de temps au reste de leur formation…
Enfin, je ne pense pas avoir utilisé le terme de « parfait bilingue », mais comme je vous l’ai signalé, je peux me tromper car n’ai pu « relire » mon interview.
En tout cas, je n’ai utilisé ce terme ni dans l’annonce orale que j’ai faite à la communauté universitaire le 12 janvier, ni dans l’article de mon « blog » qui y est consacré et que vous pouvez consulter.
Et ceci pour une simple raison. Comme vous, j’aime et je pratique l’anglais (depuis près de 50 ans maintenant dans mon cas !), j’ai vécu 5 ans aux Etats-Unis et je prétends parler couramment l’anglais (ou l’américain, comme vous voudrez !), mais je ne prétends pas être parfait bilingue non plus. C’est donc un terme que j’évite sciemment, mais ça a pu m’échapper.
Ce que je souhaite, ce n’est rien de plus qu’offrir à tous les étudiants de l’ULg l’assurance de sortir de notre université avec la capacité de comprendre, à un simple niveau usuel, une langue qui n’est pas leur langue maternelle, et d’arriver à se faire comprendre dans cette langue. Ce n’est pas le cas pour tous aujourd’hui. Mon ambition n’est donc pas considérable mais elle est justifiée, je pense. On ne peut faire moins.
J’ajouterai qu’il s’agit d’une initiative du recteur de l’ULg, totalement indépendante de ce qui se fait ou ne se fait pas dans les autres universités francophones belges. Je pense, en fait, que cela donnera à l’ULg une avance sur les autres institutions à cet égard.
En vous remerciant pour vos questions et commentaires, recevez, chère Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Bernard Rentier
**********
Monsieur le Recteur,
Suite à votre long courriel, je tiens à vous remercier d’avoir pris la peine de répondre clairement et en détail à mes questions.
Une fois de plus, on est amené à se poser de multiples questions sur le respect et la transformation des propos d’un interlocuteur par les médias. Après avoir lu votre lettre, j’en viens même à me demander si je n’ai pas rêvé mais je n’ai pourtant pas inventé les chiffres qui ont été cités par le (ou la … je ne sais plus) journaliste.
Vu l’importance du projet dont il avait été question à la radio, je me demandais d’où les crédits allaient venir pour le réaliser mais je n’étais pas consciente qu’il y avait déjà autant de formations existantes en langues à l’Université de Liège. Nulle n’était mon intention de me mêler de ce qui ne me regardait pas et je suis confuse si vous l’avez pris de cette façon. Je tiens à m’en excuser.
Grâce à votre courriel, je pourrai rassurer certains élèves (les faibles en langues surtout !) qui étaient plutôt angoissés à l’idée de continuer à avoir 5 ou 6 heures de langues à l’université.
Je vous prie de croire, Monsieur le Recteur, à mon profond respect.