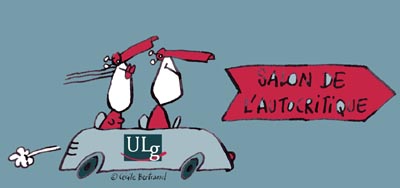dim 12 fév 2006
Propriété intellectuelle
Posté par Bernard Rentier dans Recherche , Relations extérieures1 Commentaire
Dans une société où le profit règne en maître, le financement public de l’enseignement en général et celui de l’Université en particulier laisse de plus en plus à désirer, à tel point que la qualité-même de la formation des jeunes est gravement menacée, de même que la formation permanente des adultes tout au long de leur vie (formation non subventionnée !), ce qui nous place dans une position peu enviable par rapport à la majorité des autres pays européens et nord-américains, voire même des pays dits « émergents » ou « en développement ».
Il s’agit de choix et d’options politiques de gouvernance publique. J’en resterai là.
Quoi qu’il en soit, cette carence a obligé les universités à revoir leur propre politique d’acquisition de moyens de fonctionnement afin de ne pas voir décliner la qualité de leurs missions.
Auparavant, les découvertes issues de la recherche universitaire étaient tout simplement rendues publiques par les articles que publiaient les chercheurs. Ceci permettait une bonne diffusion de l’information et des progrès du savoir.
Aujourd’hui, si ceci reste vrai pour ce qui concerne les recherches dont on voit mal les champs immédiats d’application, les choses ont changé pour ce qui est des recherches applicables ou potentiellement applicables. De plus en plus, ces recherches sont « valorisées » et rapportent, dans une mesure très variable, des moyens à l’Université et au département ou au centre, ainsi qu’aux chercheurs qui ont pris les mesures adéquates.
On aime ou on n’aime pas ce mode de fonctionnement, mais on ne peut nier qu’il soit juste que la propriété intellectuelle des découvertes et inventions puisse être affirmée, réclamée, protégée et défendue. Cette évidence est encore renforcée dans un contexte où la recherche publique est notoirement sous-financée. Au sein de l’Université, peu de chercheurs ont les moyens et/ou le savoir-faire nécessaires pour assurer seuls ces démarches. Moins encore sont disposés à y consacrer du temps et nous parlons ici de beaucoup de temps.
Les universités ont donc mis sur pied des dispositifs permettant de soulager les chercheurs de ces tâches — en bonne partie du moins, leur expertise restant indispensable — et de professionnaliser cette fonction. C’est ainsi que sont nés à l’ULg ses « outils » de valorisation: l’Interface Entreprises-Université il y a quinze ans, Gesval puis SpinVenture, Science Park Service, SPS, WSL, GIGA et Aquapôle plus récemment et dernièrement CIDE.
• L’Interface a pour tâche d’identifier au sein de l’Université les recherches valorisables, de construire un réseau de relations avec les entreprises et d’établir le contact entre les chercheurs et les entreprises afin de trouver les meilleures voies de valorisation de la recherche universitaire. Ceci implique une activité prospective, mais également une activité pédagogique et d’animation technologique, l’organisation de conférences, colloques, séances de travail permettant d’augmenter les chances de rencontre et de collaboration entre l’ULg et le monde des entreprises, privées ou publiques.
• Gesval est une s.a. dont l’ULg est l’actionnaire principal, à 99,9%. Son rôle est l’évaluation technico-économique des développements universitaires, l’aide à la prise de décision en matière de brevets, la recherche de partenaires pour la valorisation, la négociation et la rédaction de contrats de transfert et enfin, l’aide à la décision avant la création et le suivi d’entreprises « spin-off ».
• SpinVenture est une s.a. dont l’ULg et Meusinvest sont actionnaires paritaires et dont le but est d’aider les chercheurs à trouver le capital d’amorçage pour la création d’une spin-off au cas où cette voie de valorisation a été considérée comme la plus adéquate.
• SPS est également une s.a. de l’ULg et de Meusinvest qui a pour mission d’offrir des espaces immobiliers pour les entreprises de haute technologie qui souhaitent une proximité étroite avec l’Université.
• WSL, GIGA et Aquapôle sont des incubateurs de haute technologie pour les entreprises naissantes dans les domaines de l’ingeniérie, de la biotechnologie et de l’eau, qui favorisent l’interaction permanente et étroite entre entreprises et centres de recherche universitaires.
• CIDE est une asbl créée par l’ULg et Meusinvest en vue de soutenir activement l’innovation et la création d’entreprises dans notre région. Au sein de CIDE sont regroupées les compétences de SEED-ULg, qui fut créé par le Prof. B. Surlemont au Centre d’entreprenariat de HEC-ULg, et celles de PI2, ou centre Patlib, lui-même intégré à l’Interface.
L’ULg encourage tous ceux qui, parmi ses chercheurs s’interrogent sur le caractère nouveau d’une technologie, ou sur la liberté qu’ils ont de l’exploiter, à recourir à l’instrument PI2 (Propriété Intellectuelle et Innovation), extrêmement performant à cet égard. Intégré dans un réseau européen de plus de 300 centres du même type, PI2 est officiellement reconnu par l’Office européen des brevets (OEB) et par l’office national belge des brevets: l’Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI).
PI2 étant maintenant incorporé dans CIDE, c’est là qu’il convient de s’adresser lorsque l’on veut répondre de la meilleure manière aux appels à projets de la Région Wallonne, par exemple, qui pose clairement, dans ses formulaires, la question de la nouveauté et de la liberté d’exploitation. Cette opportunité existe également pour les chercheurs des autres universités, centres de recherche ou entreprises qui ont le loisir de profiter des performances de PI2. L’ULg a pris un abonnement à PI2 pour ses membres et d’autres peuvent évidemment en faire de même.
Mais il est important de savoir que la gestion de la propriété intellectuelle de l’ULg n’est pas l’affaire de PI2, pas plus que le suivi des procédures liées à la prise et au maintien de brevets. Cette gestion est prise en charge par l’ULg qui la confie à Gesval car c’est là qu’est accompagné tout le processus de valorisation, depuis le recueil des annonces d’invention jusqu’au suivi des licences d’exploitation. Gesval aura alors éventuellement recours à PI2 pour la recherche des informations liées au marché.

Looking for seed funding!
(Photo Grant Heffernan, www.photoslave.com/ journal/2002/09.html)