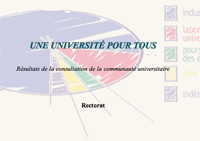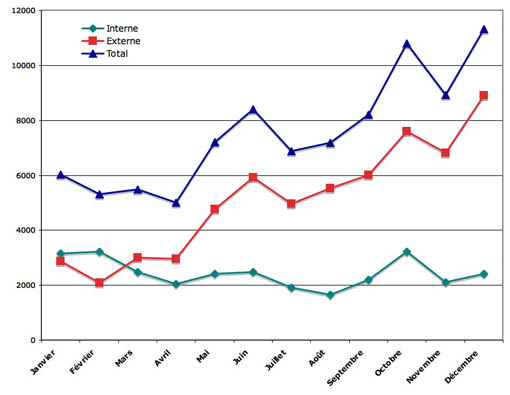Trois interventions prononcées le 29 mars 2007 lors de la cérémonie officielle de remise des insignes de Docteur honoris causa.
Les dix personnalités que nous honorons ce jour ont toutes quelque chose en commun, quelque chose que nous souhaitons mettre en évidence en cette occasion, c’est cette force qui consiste à aller jusqu’au bout de ses idées, jusqu’au bout de ses opinions, lorsqu’on y croit fermement et quoi qu’il en coûte. Les huit premières ont su accomplir un parcours exemplaire dans leur domaine de recherche et y atteindre des sommets du haut desquels elles ont été remarquées par nos collègues, distinguées, proposées et enfin élues par une écrasante majorité du corps académique tout entier. Nul ne peut accéder à ce niveau de reconnaissance s’il n’a développé une opiniâtreté, voire une obstination sans limites pour atteindre le but fixé. Une telle réussite n’est jamais le fruit du hasard, même si celui-ci peut apporter son clin d’œil dans le parcours de chacun d’entre nous. Vous l’entendrez dans les présentations, cette persévérance se retrouve chez chacun d’eux.
Chez deux d’entre eux, cette qualité est poussée à l’extrême, jusqu’au mépris de leur liberté si elle doit être le prix à payer pour l’expression de leurs convictions. Comme l’écrivait Alessandro Baricco dans son roman « City » en 2000, « C’est un élément constitutif du génie que cette obstination sans limites qui le pousse à poursuivre ses propres objectifs avec un souci hypertrophié de perfection ».
Nous ferons connaissance aujourd’hui de caractères bien trempés qui, au delà des mérites scientifiques dont on vous fera part, ont su aller au bout de leur idéal et joindre à leurs talents de chercheurs, une grande générosité d’âme. C’est ainsi que nous rencontrerons notamment une juriste qui a su appréhender les grands débats sur la crise du domaine public, sur les partenariats public-privé, sur les questions d’environnement, sur les services publics, un physicien qui a pris fait et cause pour le développement d’institutions universitaires renommées dans le pays dont il est originaire, un spécialiste des greffes qui a su entrer dans le combat politique comme Député de son département, un généticien qui a pris son bâton de pèlerin pour participer à d’innombrables débats éthiques sur les biotechnologies, le clonage humain ou l’assistance médicale à la procréation.
Tous ont su donner à leur métier, à leur passion, un relief particulier et nous sommes fiers de les avoir avec nous, à l’Université de Liège aujourd’hui.
En outre, ils sont tous la démonstration de ce que la formation en recherche permet de développer comme personnalités exceptionnelles. Ils sont la preuve du bien-fondé de l’investissement que leur pays a fait en soutenant leurs travaux.
Il y a bientôt 80 ans, le 1er octobre 1927, non loin d’ici, dans une halle industrielle de la société John Cockerill à Seraing, le Roi Albert I prononçait devant un parterre nombreux prestigieux un discours devenu immédiatement célèbre et qui allait immédiatement influencer la totalité de la vie universitaire et de la recherche de Belgique. Il y disait: « La science moderne ouvre des perspectives nouvelles et presque infinies à la technique. C’est dans les laboratoires de recherches que s’élaborent les rudiments de l’industrie future, et cependant l’on ne peut se défendre de quelque inquiétude lorsque l’on constate la pénurie des moyens matériels dont les hommes de science disposent aujourd’hui chez nous pour poursuivre leurs études et leurs travaux. […] Le public ne comprend pas assez, chez nous, que la science pure est la condition indispensable de la science appliquée et que le sort des nations qui négligeront la science et les savants est marqué pour la décadence. […] Il faut que nous trouvions tous ensemble les moyens pratiques de promouvoir la science et d’encourager les chercheurs et les savants ».
Dans ce discours dont on ressent terriblement l’actualité aujourd’hui encore, le Roi mettait le doigt sur l’ensemble des problématiques liées à la recherche et à son financement, en précisant avec une acuité étonnante, au cœur d’une entreprise à l’époque florissante, les liens séquentiels entre la recherche pure et la recherche appliquée et l’impossibilité pour la seconde de se développer sans l’insémination par la première. Que cet appel ait abouti, dans les mois qui suivirent, à la création du FNRS, de la Fondation universitaire et de la Fondation Franqui, avec ses chaires et ses prix, des institutions qui ont soutenu depuis lors l’ensemble de la recherche fondamentale belge.
Nous aurons à cœur, avec le FNRS, de célébrer ce quatre-vingtième anniversaire le premier octobre prochain, sur les lieux-mêmes de cet événement, afin de rappeler à chacun la portée de ces paroles visionnaires.
Dans d’autres domaines que celui de la recherche, cette persévérance au service d’un but est parfaitement illustrée avec deux de nos lauréats qui l’ont menée au plus loin qui soit, dans l’exercice de leur métier d’avocat, d’écrivain et de responsable politique.
Ce courage d’aller jusqu’au bout de soi-même que nous célébrons aujourd’hui se reflétait par ailleurs dans la devise de John Cockerill: « Courage to the last ».
C’est Jules Renard qui, dans son journal, en 1901, écrivait « L’homme libre est celui qui ne craint pas d’aller jusqu’au bout de sa raison ».
C’est ce message-là que nous nous efforçons de transmettre à nos étudiants. Notre université se veut une institution prioritairement de recherche. Cette primauté se vérifie par les ressources qu’elle est capable de générer et qui dépassent celles qu’elle reçoit comme allocation en tant qu’institution d’enseignement. Cette qualité de recherche retentit évidemment sur la qualité de ses enseignements en leur apportant la modernité mais aussi la rigueur, et explique le degré d’exigence imposé à nos élèves et l’excellence de leur formation.
D’aucuns prétendent que la vertu de l’exemple n’est plus ce qu’elle était. Je n’en crois rien. L’important est de présenter l’excellence sous un jour attractif et motivant et veiller à ce que chacun puisse comprendre la relation entre l’effort et le résultat et mesurer la satisfaction du résultat. La satisfaction intellectuelle de la découverte ou de l’invention est incomparable mais elle ne peut être atteinte que par ceux qui savent aller jusqu’au bout de leurs idées, qui ont le courage de leurs opinions et qui assument leurs actes et leurs paroles.
Je suis très heureux de pouvoir honorer aujourd’hui, au nom de l’université tout entière, des personnalités qui illustrent ce propos à merveille.
Les 8 premiers lauréats sont présentés par les facultés:
Sur proposition de la Faculté de Droit: Mme Jacqueline MORAND-DEVILLER, Université Paris 1 (Panthéon – Sorbonne)
Sur proposition de la Faculté des Sciences: M. Girish Saran AGARWAL, Oklahoma State University; M. Christopher Martin DOBSON, University of Cambridge
Sur proposition de la Faculté de Médecine: Mme Nancy Lee HARRIS, Harvard Medical School; M. Jean-Michel DUBERNARD, Université de Lyon 1; M. Axel KAHN, Institut Cochin, Paris
Sur proposition de la Faculté des Sciences appliquées: M. Sanford A. KLEIN, University of Wisconsin-Madison
Sur proposition de la Faculté de Médecine vétérinaire: M. Moshe SOLLER, The Hebrew University of Jerusalem
Les deux suivants sont présentés par les Autorités universitaires:
M. Roger LALLEMAND, Ministre d’Etat, Président honoraire du Sénat de Belgique
M. Václav HAVEL, Président de la Tchécoslovaquie (1989-1992) et de la République Tchèque (1993-2003)
Roger Lallemand
Il est des personnages qui inspirent à la fois le respect et la sympathie. Parfois, ils ont en plus cette caractéristique de ne guère devoir être présentés. Roger Lallemand est de ceux-là. Ceux qui n’ont pas eu la chance de le rencontrer ont entendu parler de lui. Ses actions d’éclat, ses prises de position sans concessions sont au cœur du débat éthique et moral en Belgique et au delà de nos frontières depuis un demi-siècle.
Né en 1932 à Quevaucamps, petit bourg hennuyer proche de Belœil, il décroche une licence en philologie romane à l’Université Libre de Bruxelles ainsi qu’un doctorat en droit. A 20 ans, il accède à la Présidence du Cercle du Libre examen de l’ULB (le Librex). A 23 ans, dans l’éditorial d’un numéro des Cahiers du Cercle, il écrit : « Le sujet de ce Cahier est de ceux qui provoquent les réactions violentes et déchaînent les passions. Disons le net: nous cherchons la contradiction et les échanges de vue. Nous pensons qu’ainsi pourront vivre davantage un cercle et un principe qui veulent toujours affirmer leur présence et leur opportunité ». Dans ce numéro où il écrit un texte sur le racisme et un autre sur la colonisation, il invite Jean-Paul Sartre avec qui il se liera d’amitié ainsi qu’avec Simone de Beauvoir. C’est à leur exhortation qu’il partira en Bolivie en 1967 comme avocat défendre Régis Debray, détenu pour avoir soutenu Che Guevara. Et on le retrouve dans bien des causes délicates, voir dangereuses, auprès de syndicalistes et de résistants marocains, plus tard,auprès de partisans de Solidarnosc en Pologne. Il entre au Sénat en 1979 et y reste 20 ans. Il en deviendra le président.
Sur le plan des engagements éthiques, Roger Lallemand est omniprésent tout au long de sa carrière: membre du Comité Consultatif de bioéthique de Belgique, membre du Comité d’honneur de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), président de Présence et Action Culturelle (PAC) Bruxelles. Après avoir été aux côtés du Dr. Willy Peers dans l’affaire qui porte son nom, il est, avec Lucienne Herman-Michielsens, à l’origine de la loi dépénalisant partiellement l’interruption volontaire de grossesse votée dans les conditions dont on se souvient, en 1990. C’est encore lui qu’on retrouve au premier rang des protagonistes du débat sur l’euthanasie et les problèmes de fin de vie, au Sénat. Il est co-auteur de la loi qui bannit les mines antipersonnelles et qui a servi de modèle pour la communauté internationale dans le traité d’Ottawa. Comme parlementaire, il s’implique dans la répression du négationnisme, conduit une réforme de la législation sur les droits d’auteur et contribue à la reconnaissance officielle de la laïcité, Il a également représenté la Belgique au sein de la Convention Européenne qui a rédigé la Charte des droits fondamentaux. Depuis 2004, il préside la Commission du Dialogue interculturel.
Elevé au rang de Ministre d’État, Roger Lallemand est un homme qui n’a jamais abandonné la culture du doute comme valeur fondamentale. On retrouve cette préoccupation dans son analyse de la vision changeante que notre société a de ses mœurs, sa fascination pour le fait que ce qui est répréhensible aujourd’hui ne le sera plus demain. Cette relativité ne peut qu’inspirer le doute dans chaque jugement que nous portons sur les autres et sur nous-mêmes. Ami d’Edgard Morin, d’Alain Badiou, d’Alain Robbe-Grillet, il est un véritable humaniste qui a consacré sa vie à combattre nationalismes, intégrismes et intolérance, ardent défenseur de la démocratie, du pluralisme, de la justice et des libertés fondamentales et, par dessus tout, de « l’altérité de l’autre », c’est-à-dire du respect de la différence. « Il faut respecter » dit-il « l’autonomie de la personne dans les choix fondamentaux qu’elle doit faire, fussent-ils difficiles ou contestables. Une société démocratique est celle qui est capable de faire cohabiter le maximum de divergences ». Ce respect fondamental des choix autonomes des autres est réellement le fil qui sous-tend toute la vie et l’action de Roger Lallemand.
Membre du Haut Conseil de la Francophonie, co-fondateur avec Lucien Goldmann du Centre de sociologie de la littérature de l’ULB, membre du Conseil d’administration du Théâtre Royal de la Monnaie, Roger Lallemand est un personnage éclectique, féru de littérature, de poésie et d’opéra. On retrouve ce parcours dans son livre “Le songe du politique », mélange d’articles personnels, de textes inédits et de poèmes. Philosophe, poète, écrivain, érudit, grand amateur d’art et de bonne chère, Roger Lallemand ajoute encore une palette de qualités à toutes celles qui ont tout naturellement amené les autorités de l’Université de Liège à lui conférer les insignes de Docteur Honoris Causa.
Václav Havel
Ce que j’ai dit à propos de Roger Lallemand sur les personnages qui inspirent à la fois le respect et la sympathie s’applique parfaitement à Václav Havel, de même que sur le peu de nécessité de le présenter.
Vous reconnaîtrez les traits communs entre ces deux grands hommes à la simple lecture d’un texte de Havel parlant de lui-même: « Je suis un écrivain qui qui n’a jamais su rester en place et qui s’est toujours engagé comme un citoyen. Je suis un homme qui a toujours placé les intérêts de la société avant ses intérêts personnels ».
Né en 1936 à Prague dans une famille bourgeoise d’entrepreneurs tchèques, il voit très jeune son entourage proche subir de plein fouet la nationalisation des biens par le régime installé à la sortie de la guerre. Montré du doigt comme un privilégié à humilier en raison de la lutte des classes, il souffre terriblement de cette discrimination. Son père est un petit employé dans sa propre entreprise et sa mère vend des cartes postales. C’est pour lui ce qu’il appelle « l’expérience de l’absurde », une vision d’en bas, de l’extérieur. A 15 ans, en représailles contre ses origines, on l’oblige à cesser ses études et à travailler comme ouvrier. Il suit des cours du soir et obtient son bac. Très tôt, il se lance dans une vie artistique très active, écrit, fonde un club littéraire, fréquente poètes et écrivains. Il publie son premier ouvrage à 20 ans. Très vite, il s’oriente vers une écriture pour le théâtre, faisant preuve d’une excellente verve satyrique et s’amuse à décortiquer le langage idéologique dominant de la Tchécoslovaquie des années ’60, apportant une réelle fraîcheur sur la scène théâtrale de son pays. Il publie des recueils de poèmes et devient membre du comité de rédaction d’un mensuel consacré à la jeune littérature. En devant se battre pour la survie de cette revue non conventionnelle face à l’Union des Ecrivains très en ligne avec le régime, il est amené à adopter une attitude politique militante qui, comme il le dira lui-même, l’amènera « sur les chemins de la dissidence ».
L’échec du Printemps de Prague et la répression brutale qui s’ensuit font de Václav Havel un auteur interdit, poursuivi et condamné. Dès lors, ses écrits deviennent très critiques de la société et du régime en place mais heureusement il est primé aux Etats-Unis et ce début de gloire internationale l’immunise quelque peu et l’enhardit. La lettre ouverte qu’il adresse en 1975 au président tchécoslovaque, dans laquelle il dénonce la situation critique de la société et la responsabilité du régime politique, connaît un large retentissement et le fait connaître sur la scène internationale comme un représentant de l’opposition intellectuelle tchécoslovaque. Il rédige avec deux amis la fameuse « Charte 77″ qui deviendra le symbole de la résistance tchèque jusqu’au renversement du régime, de nombreuses années plus tard.
Il connaît plusieurs emprisonnements successifs entrecoupés de périodes de liberté surveillée durant lesquelles il est victime de poursuites incessantes et de tracasseries policières permanentes, peur, humiliations, délation, insultes. Et cependant, il continue à écrire, ses œuvres illustrant parfaitement l’inanité et l’absurdité du monde dans lequel lui et ses concitoyens sont obligés de vivre. Son leitmotiv, qui le soutiendra tout au long de ces épreuves, est « ne pas céder sur la vérité, même et surtout dans les petites choses qui paraissent insignifiantes, en ne perdant ni patience, ni humour ». En 1978, il publie « Le pouvoir des sans-pouvoir », un essai remarquable dans lequel il analyse l’essence de l’oppression totalitaire communiste, qui engendre une société résignée composée d’individus craintifs et moralement corrompus, et démontre au contraire la force de la résistance morale et de la vie. Cet essai a un impact important chez les dissidents tchécoslovaques mais aussi auprès de mouvements d’opposition d’autres pays communistes.
En 1989, la Révolution de Velours renverse le régime communiste et Václav Havel, qui conduit un mouvement populaire, le « Forum civique » est élu Président de la République Tchécoslovaque le 29 décembre. En juin 1990, le premier gouvernement démocratique et donc entièrement non-communiste en plus de 40 ans est mis en place. Jouissant d’une grande autorité morale, le Président Havel rétablira les relations de son pays avec les grandes puissances mondiales et conduira, sur le plan interne, la démocratisation des structures de l’Etat et de la société civile. Il démissionne de ses fonctions en juillet 1992 lorsque la partition de la Tchécoslovaquie devient inéluctable. Mais en janvier 1993, il revient à l’avant-plan et est élu premier Président de la République tchèque par le Parlement. Il est réélu en 1998. Il se retire de la vie politique au terme de son mandat en 2003.
Václav Havel est incontestablement l’écrivain et dramaturge tchèque le plus original de l’après-guerre, une grande figure intellectuelle dont l’aura a dépassé son pays d’origine pour s’imposer à toute la communauté internationale comme un symbole de la défense des libertés et de la démocratie.
L’Université de Liège est fière de pouvoir accueillir en son sein Václav Havel comme Docteur Honoris Causa.